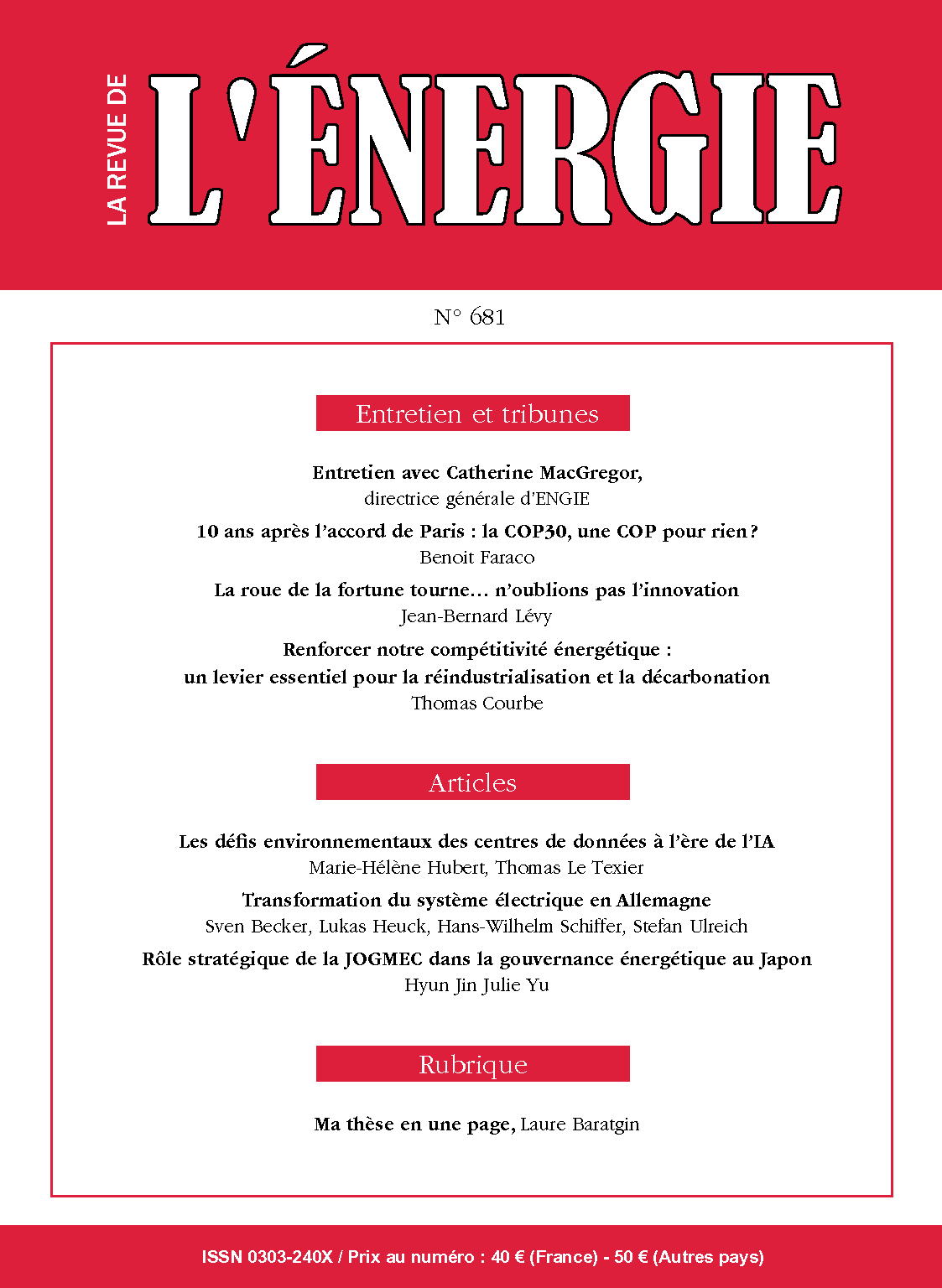Lutter contre le changement climatique implique une transformation de la manière de produire, transporter, et consommer l’énergie. L’électricité provenant des énergies renouvelables (EnR), notamment solaire et éolienne, joue un rôle crucial dans cette transition. Cependant, sa variabilité requiert des solutions de flexibilité pour maintenir l’équilibre entre offre et demande d’électricité. Dans ce contexte, la production d’hydrogène à partir d’électricité (Power-to-Gas, ou PtG) est une solution prometteuse pour parvenir à une électrification plus large en (i) remplaçant les sources d’énergie fossile dans les secteurs difficiles à électrifier et en (ii) apportant de la flexibilité au système électrique en élargissant les options d’utilisation des EnR.
Le développement conjoint de l’électricité et de l’hydrogène renouvelable est essentiel pour atteindre la neutralité carbone dans le secteur de l’énergie. Les travaux de recherche intégrant à la fois l’électricité et l’hydrogène sont cruciaux pour comprendre les interactions économiques et physiques entre ces deux systèmes. Dans ce contexte, cette thèse présente trois études apportant un éclairage sur l’économie des systèmes électricité-hydrogène.
Nous nous sommes tout d’abord intéressés à l’organisation industrielle des actifs PtG, en étudiant comment la structure de propriété retenue pour ces actifs affecte leur utilisation dans un contexte de marchés imparfaitement concurrentiels. Pour cela, nous avons développé un modèle par agents, capturant les interactions entre les acteurs des marchés de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène, et avons comparé différents scénarios où le PtG appartient à différents acteurs de ces marchés. Nos résultats montrent que l’utilisation du PtG dépend du profil de son propriétaire : les producteurs d’hydrogène d’origine fossile l’exploitent peu, tandis que les producteurs d’EnR en tirent des bénéfices élevés. Le gain social maximal est atteint lorsque le PtG est exploité par un opérateur sans pouvoir de marché, alors qu’une possession par un producteur d’EnR produit l’un des gains sociaux les plus faibles et stimule la production d’électricité carbonée.
Nous avons ensuite analysé les interactions entre le stockage d’électricité par batterie (BESS) et le stockage souterrain d’hydrogène (UHS). Nous avons développé un modèle dynamique stochastique pour étudier les décisions d’investissement et d’opération de ces stockages, et avons calculé le taux marginal de substitution technique entre les deux technologies pour évaluer leur degré de complémentarité. L’Allemagne a été retenue comme étude de cas en raison de son fort potentiel pour le développement de l’UHS. Nos résultats indiquent que le BESS et l’UHS ont des fonctions complémentaires. Le stockage BESS est essentiel pour gérer les fluctuations journalières, tandis que l’UHS fournit une assurance contre les longues périodes de faible production d’électricité. L’utilisation du modèle stochastique sur cent années climatiques a également permis de souligner la forte volatilité des profits de l’UHS, pouvant constituer une barrière à son déploiement.
Enfin, nous avons examiné comment les contraintes de disponibilité en eau affectent le système électricité-hydrogène. Pour cela, nous avons développé un modèle d’optimisation linéaire incluant une contrainte de disponibilité en eau, et avons comparé deux scénarios climatiques. À partir des résultats du modèle, nous avons appliqué le critère de minimax regret afin d’évaluer s’il est préférable d’anticiper une baisse des ressources en eau ou d’en assumer les conséquences a posteriori. Nous avons pris la France comme étude de cas en raison de la richesse de ses données hydriques. Les résultats révèlent qu’anticiper cette raréfaction conduit à augmenter les investissements dans les EnR et le PtG pour compenser les baisses de production dans certains bassins hydrographiques en été. Le critère de minimax regret confirme qu’une telle stratégie est économiquement préférable.
Laboratoire d’accueil
Cette thèse a été réalisée à CentraleSupélec, Université Paris-Saclay, au sein de l’École doctorale INTERFACES (ED 573) et à IFP School, avec le soutien de la chaire Économie du Gaz. Camille Megy était attachée au Sustainable Economy Research Group (SERG) du Laboratoire Génie Industriel (LGI) de CentraleSupélec. Les travaux du SERG couvrent les domaines de l’économie et des sciences de gestion, avec un accent particulier sur leurs interactions avec les sciences de l’ingénieur. Ils se structurent en trois axes de recherche : (i) les systèmes de mobilité durable, incluant transports publics, véhicules électriques, navettes autonomes, la mobilité en tant que service, et les interactions entre mobilité et électricité via le stockage, (ii) les systèmes énergétiques bas carbone, incluant les technologies émergentes (énergies renouvelables, hydrogène, stockage, biométhane), ainsi que la conception des marchés, les cadres réglementaires et les enjeux concurrentiels, et (iii) les stratégies de lutte contre le changement climatique, traitant de la comptabilité du carbone, les technologies de captage et d’émissions négatives, ainsi que leurs mécanismes de financement et cadres institutionnels. Le directeur du LGI est Bernard Yannou, et le responsable du SERG est Pascal Da Costa.

Pour plus d’informations : https://www.centralesupelec.fr/fr/lgi-laboratoire-genie-industriel et https://www.serg.paris/.
Soutenance de la thèse
La thèse a été soutenue le 5 novembre 2024 à Centrale Supélec, Université Paris-Saclay, devant un jury composé de : Oualid Jouini, professeur des universités, CentraleSupélec (président) ; Franziska Holz, directrice de recherche, DIW Berlin (rapporteure) ; Vincent Bertrand, maître de conférences HDR, Université de Franche-Comté (rapporteur) ; Machiel Mulder, professeur des universités, Université de Groningen (examinateur) ; Charles Weymuller, chef économiste, EDF (examinateur) ; Olivier Massol, professeur des universités, CentraleSupélec (directeur) ; et Yannick Perez, professeur des universités, CentraleSupélec (co-directeur).
Le résumé de la thèse est disponible sur : https://theses.fr/s307030.
Le manuscrit sera disponible à cette même adresse à partir du 6 novembre 2025.
Et après la thèse ?
Camille Megy est actuellement ingénieure chercheuse au sein de l’institut I-Tésé, institut de recherche et d’études en économie de l’énergie du CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives). Elle travaille au sein de l’équipe modélisation de cet institut, et contribue au développement du modèle ESMOD (European Electric System Modelling), dans le but d’y intégrer une modélisation hydrogène.