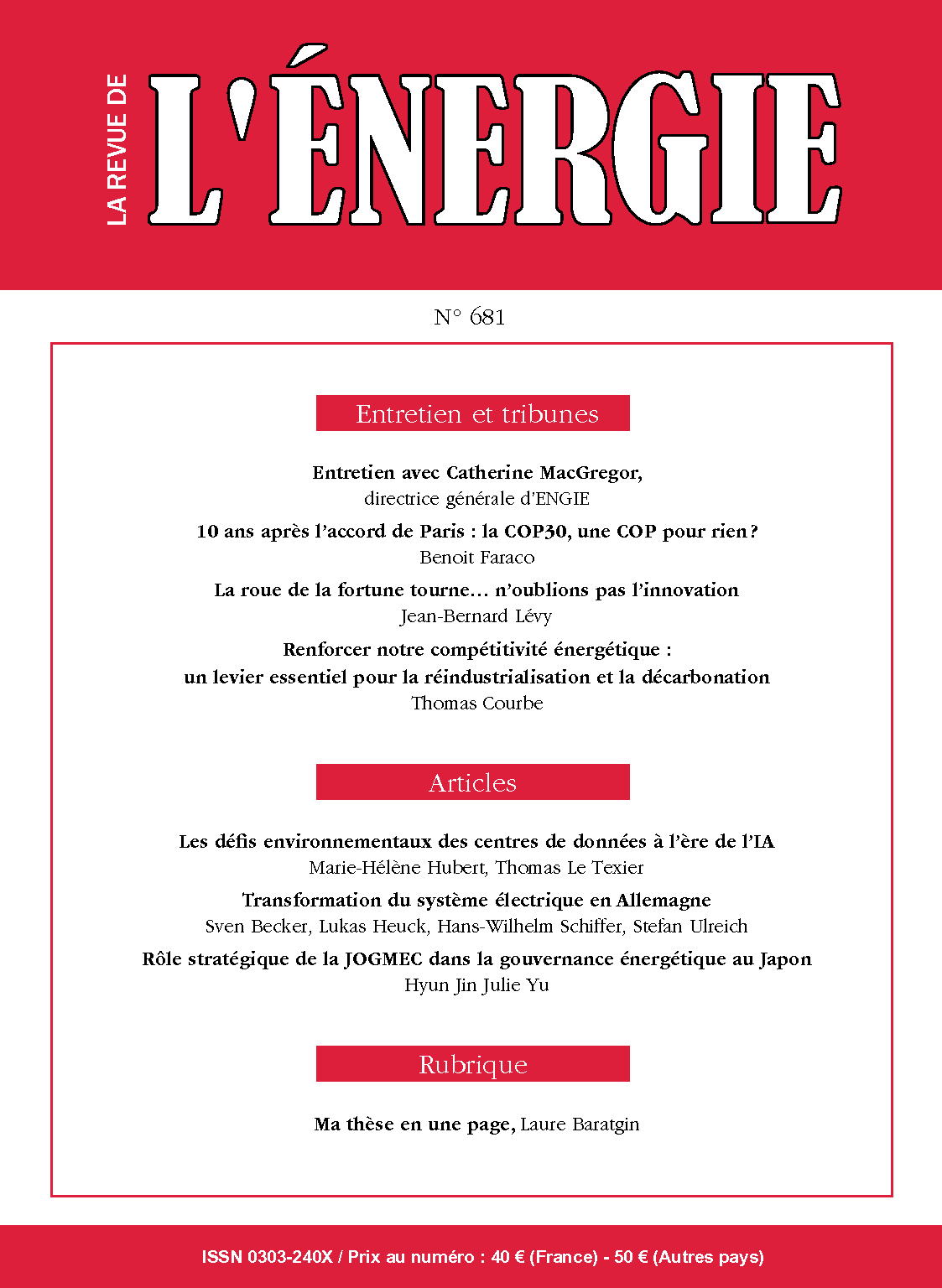L’ouvrage que nous propose Jean-Paul Bouttes est une fresque qui retrace les grandes mutations des systèmes énergétiques sous un angle à la fois historique, technique et géopolitique. Il présente une originalité qui le rend vivant et pédagogique : c’est un dialogue entre l’auteur et un représentant de La Pensée écologique, Dominique Bourg. L’entretien est divisé en trois parties : généralités et histoire, sources d’énergie, scénarios énergétiques. On ne peut pas rendre compte ici de toute la richesse de l’ouvrage et nous avons choisi de sélectionner certains thèmes.
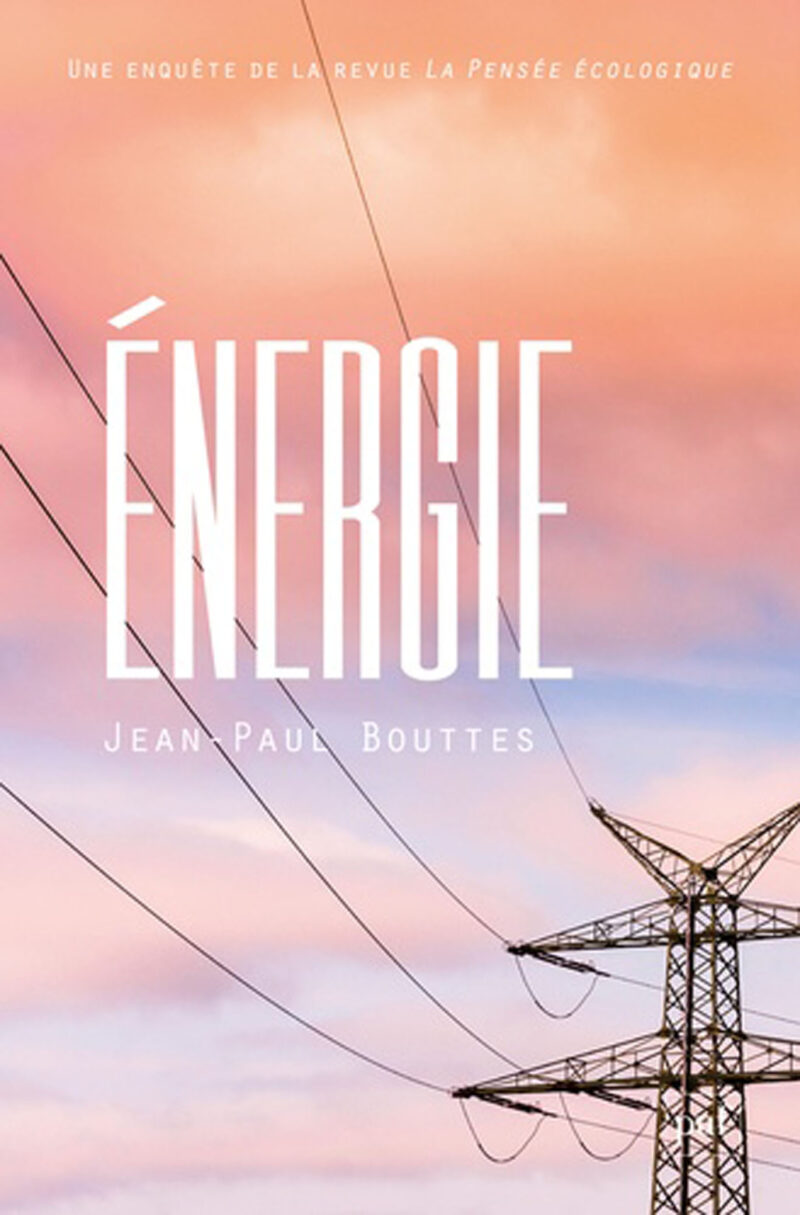
La première partie, la plus longue, nous entraîne de la Grèce antique à nos jours. Elle commence par rappeler quelques évidences : l’énergie ne se produit pas et ne se consomme pas mais elle se transforme d’une forme en une autre, plus ou moins adaptées aux besoins qui sont les nôtres. C’est la loi de la conservation du premier principe de la thermodynamique. Les sociétés ont besoin d’une énergie dense, transportable et stockable. Avec une éolienne, l’une des premières énergies utilisées dans le passé lointain, il faut récupérer l’énergie cinétique de 20 000 m3 d’air arrivant à 60 km/h pour produire 1 kWh ; ou faire chuter 10 tonnes d’eau de 40 mètres dans une installation hydroélectrique. Sachant que la consommation d’un ménage français d’aujourd’hui est de 10 à 20 kWh par jour, on mesure l’importance des matières à mobiliser. À l’opposé, l’énergie chimique d’un kilogramme de pétrole équivaut à 12 kWh. C’est donc une énergie beaucoup plus dense et stockable. Avec le nucléaire, il suffit de 10 mg d’uranium naturel pour produire 1 kWh. Le nucléaire est donc beaucoup plus dense que le pétrole, lui-même beaucoup plus dense que les énergies de flux comme le solaire ou l’éolien. Ce sont les innovations technologiques qui vont progressivement permettre l’émergence de la révolution industrielle en créant de nouveaux convertisseurs d’énergie dans tous les secteurs. L’exemple représentatif est celui de la machine à vapeur.
Mais pourquoi ces révolutions industrielles se sont-elles développées en Europe et pas en Chine à l’époque ? Est-ce le contexte culturel, le rôle des politiques publiques ? C’est une question complexe, nous explique l’auteur. Ce n’est toutefois que dans les deux derniers siècles que le monde énergétique a connu un véritable bouleversement avec une montée spectaculaire du niveau de vie et de la consommation d’énergie par tête. Mais cela s’est aussi accompagné d’une montée des inégalités selon les régions du monde, que l’on retrouve aujourd’hui dans la façon dont s’opère la décarbonation de l’énergie et de l’électricité en particulier.
L’ouvrage s’attarde ensuite sur la transition vers une électricité décarbonée et les contraintes que cela fait peser sur les réseaux qui doivent en permanence maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande. Cela requiert de la flexibilité du côté de la demande et incite à développer le stockage de l’électricité du fait même du poids croissant des énergies renouvelables intermittentes et non pilotables. Une attention particulière est apportée aux enjeux industriels des choix énergétiques, notamment à ceux du nucléaire. La gestion des déchets radioactifs est une préoccupation que connaît bien l’auteur qui y a consacré un rapport très complet publié par Fondapol.
La seconde partie de l’ouvrage est centrée sur les caractéristiques des diverses sources d’énergie et vecteurs énergétiques. Il ne faut pas confondre source et vecteur : le charbon, le pétrole et le gaz sont des sources énergétiques ; l’électricité et l’hydrogène sont des vecteurs énergétiques. Le vecteur, c’est ce qui permet à l’énergie, en partant d’une source, d’arriver au bon moment, au bon endroit et sous la bonne forme pour répondre à un besoin ou à un usage. L’électricité est une forme particulièrement adaptée à la quasi-totalité des usages. L’auteur insiste sur le rôle des réseaux électriques, notamment des interconnexions transnationales, à la fois pour le secours mutuel et pour les échanges commerciaux. Les sources d’énergie sont de deux catégories : des énergies de stock, denses comme le pétrole, le charbon, le gaz, le nucléaire, d’une part, des énergies de flux, diffuses et très peu denses, comme le solaire et l’éolien, d’autre part. La biomasse moderne est également une source qui va jouer un rôle important dans le futur. Cette biomasse recourt au bois issu des forêts et aux résidus agricoles, de l’industrie agroalimentaire ou des ordures ménagères. Les progrès réalisés dans le domaine des convertisseurs modernes de la biomasse ont permis de mettre au point une grande variété de techniques qui vont jouer un rôle important dans la transition énergétique : gazéification des déchets agricoles ou ménagers, biocarburants notamment. Ces nouvelles formes de biomasse ont vocation à se substituer aux énergies fossiles dans certains usages, en particulier dans le transport à longue distance ou dans certains process industriels. La biomasse reste cependant limitée par des contraintes d’espace et par les arbitrages qu’il faudra faire avec d’autres usages comme l’agriculture.
L’auteur met aussi l’accent sur le fait que, contrairement à certaines idées reçues, la substitution aux énergies fossiles des sources d’énergie décarbonées, et en particulier des sources renouvelables, ne va pas diminuer l’importance des enjeux géopolitiques. Dans le nouveau monde bas carbone, la maîtrise de la fabrication et de la maintenance des nouveaux convertisseurs d’énergie (panneaux photovoltaïques, éoliennes, batteries électriques) sera au cœur de la sécurité d’approvisionnement et du contrôle de matériaux critiques indispensables à la transition.
La troisième partie de l’ouvrage, plus courte, aborde les scénarios énergétiques à l’horizon 2050, ceux de l’AIE (notamment le Net Zero), du GIEC et de RTE. Il existe des usages difficiles à électrifier et qui représentent un tiers de l’énergie primaire et de l’ordre de la moitié de l’énergie finale consommée. Il s’agit en particulier de certains process industriels et du transport à longue distance, déjà évoqués. L’auteur rappelle que dans les scénarios de RTE les mix les plus efficaces, donc les moins coûteux, sont ceux où la part du nucléaire est la plus importante, ceci quelles que soient les hypothèses. Dans tous les cas, la sobriété énergétique reste une priorité.
L’auteur aborde ensuite le rôle des pouvoirs publics et regrette que l’État ait progressivement renoncé à sa responsabilité globale concernant les choix énergétiques de long terme. Cela s’est fait par l’éclatement de son pouvoir entre diverses agences spécialisées et une confiance excessive dans le rôle du marché et de la concurrence. C’est particulièrement vrai dans le secteur de l’électricité. L’optimisation à court terme fondée sur l’ordre de mérite n’a rien à voir avec la tarification au coût marginal de long terme préconisée par Marcel Boiteux. On sacrifie le long terme au court terme et l’auteur n’hésite pas à parler de market failure et de government failure. On ne peut pas se reposer sur les seuls marchés : l’État et les politiques doivent assumer leur rôle et s’appuyer davantage sur l’expertise scientifique et industrielle, ce qui requiert d’ailleurs des réformes institutionnelles.
In fine, l’auteur rappelle que l’énergie est avant tout une question de réseaux et d’industrie. En matière de disponibilité énergétique, le facteur limitant ne se situe pas du côté des sources d’énergie mais du côté des convertisseurs du fait des contraintes écologiques et de la disponibilité des matériaux.
En refermant ce livre, le lecteur aura une vision d’ensemble et argumentée des enjeux et contraintes du système énergétique présent et de la façon dont les mutations peuvent s’opérer demain pour respecter nos engagements climatiques. La très bonne connaissance du monde de l’énergie, l’expérience qu’il a acquise dans des fonctions de haute responsabilité à EDF, permettent à l’auteur d’expliquer en termes accessibles et très pédagogiques les complexités d’une industrie qui a fortement façonné le monde dans lequel nous vivons. Cet ouvrage s’adresse aussi bien au milieu académique qu’au milieu des professionnels de l’énergie, voire à un public plus large. Ce n’est pas un hasard s’il a obtenu un prix prestigieux de l’Académie des Sciences morales et politiques.
Référence
Bouttes Jean-Paul. Énergie, PUF, 375 pages.