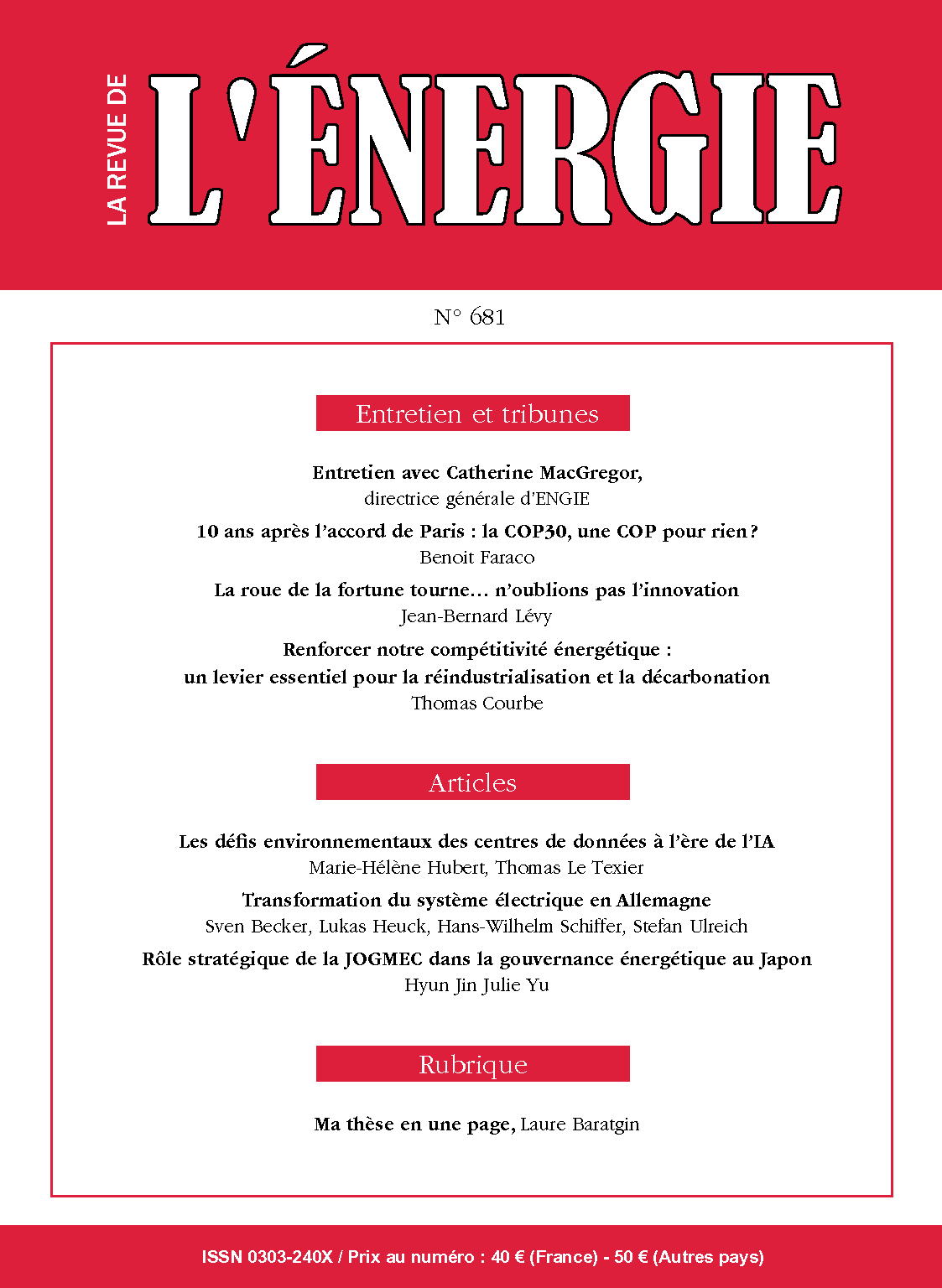La méthanisation est une activité de valorisation énergétique de la biomasse permettant la production de deux coproduits : le biogaz et le digestat. Le biogaz est un gaz constitué en majorité de méthane et de dioxyde de carbone qualifié d’énergie renouvelable au sens du droit de l’Union européenne et du droit national. Son épuration permet l’obtention de « biométhane », un gaz qui présente des caractéristiques physico-chimiques similaires à celles du gaz naturel fossile et qui peut, à ce titre, s’y substituer dans tous ses usages. Le biométhane peut être injecté dans les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel. Le digestat est un résidu azoté liquide pouvant servir de fertilisant sur les terres agricoles.
La méthanisation est une activité singulière parce qu’elle se situe à la croisée de plusieurs politiques publiques. Activité de production de gaz renouvelable, elle s’inscrit dans la politique de transition énergétique tout en se distinguant des autres modes de production d’énergies renouvelables à plusieurs égards. D’une part, elle présente l’originalité d’être une activité de valorisation énergétique de matières organiques de natures diverses concourant à l’atteinte des objectifs en matière de gestion des déchets et participant à la transition vers une économie circulaire. D’autre part, elle s’inscrit dans la transition agroécologique en ce qu’elle est une nouvelle activité agricole permettant la valorisation de déchets agricoles et la production d’un engrais naturel.
La thèse soutenue a pour objectif de déplier le cadre juridique applicable à la méthanisation. L’autrice y propose un exposé détaillé et inédit de l’ensemble des règles encadrant le développement et l’exercice de l’activité de méthanisation et la valorisation de ses produits. À travers l’étude de ces normes, le travail entend mettre en lumière le rôle paradoxal qu’endosse l’objectif de protection de l’environnement dans la construction de ce cadre juridique. Entre promotion et limitation de l’activité, cet objectif est la source d’injonctions contradictoires pour le législateur.
Dans une première partie, l’étude s’attache à démontrer que la protection de l’environnement constitue le motif du développement de la méthanisation. La méthanisation contribue à l’atteinte de cet objectif. Son essor est, à ce titre, encouragé
par les pouvoirs publics et le législateur. Les deux moyens de promotion de la filière sont exposés dans la thèse : la planification du développement de la filière, stratégique comme spatiale, et les procédures d’autorisation de l’implantation et de l’exploitation des installations ou de l’utilisation et de la commercialisation des deux coproduits.
Dans une seconde partie, l’étude s’attache à démontrer que la protection de l’environnement constitue le motif de l’encadrement de la méthanisation. L’activité présente des risques d’atteintes à l’environnement liés au traitement de déchets
ou à la production de gaz. Afin de les prévenir, le législateur a défini les conditions du développement de l’activité. Il s’agit des règles imposant l’absence de risque sanitaire ou d’incidence environnementale des projets ou les critères de durabilité.
La massification du contentieux de nature administrative, civile ou pénale illustre également le contrôle exercé sur la filière. Le contentieux est tout autant un moyen d’expression de l’opposition locale aux projets et un moyen de maîtriser l’essor d’une activité pour le respect des prescriptions en matière environnementale.
Ainsi, l’autrice entend montrer que le travail du législateur dans l’encadrement de la production d’énergie renouvelable, telle que la méthanisation, consiste en la recherche d’un équilibre entre les objectifs de développement et la prévention des atteintes à l’environnement.
Laboratoire d’accueil
La thèse a été réalisée au sein de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS), laboratoire rattaché à l’École doctorale de droit de la Sorbonne, sous la direction de maître Arnaud Gossement.

Le département « Sorbonne droit public et privé de l’économie » de l’IRJS a pour domaine d’expertise le droit de la régulation, en particulier la régulation par le droit de la concurrence et le droit de la régulation sectorielle. Ses activités de recherche portent sur l’activité des acteurs publics de la régulation et l’exploitation par les juristes de l’analyse économique afin de saisir le fonctionnement de certains secteurs de l’activité économique et leurs défaillances.
Pour plus d’informations : https://irjs.pantheonsorbonne.fr.
Soutenance de la thèse
La thèse a été soutenue le 4 décembre 2024 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne devant un jury composé de six membres : Jean-Charles Rotoullié, professeur de droit public à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (président) ; Claudie Boiteau, professeure de droit public à l’Université Paris Dauphine-PSL (rapporteure) ; Marie Lamoureux, professeure de droit privé à l’Université Aix-Marseille (rapporteure) ; Philippe de Ladoucette, docteur en droit et ancien président de la Commission de régulation de l’énergie (examinateur) ; Jérémie Cuche, directeur juridique adjoint de NaTran (membre invité) ; Arnaud Gossement, docteur en droit et professeur associé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (directeur de thèse).
Cette thèse a été préparée à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de maître Arnaud Gossement, dans le cadre d’un financement CIFRE à la direction juridique de NaTran.
La thèse est disponible sur : https://theses.fr/2024PA01D031.
Et après la thèse ?
Sophie de la Rochette de Rochegonde a intégré, en septembre 2024, la direction des affaires juridiques de la Commission de régulation de l’énergie. Elle occupe un poste de chargée de mission au sein du département « Transition énergétique ». Juriste spécialisée en droit public, droit de l’énergie et droit de l’environnement, ses missions portent notamment sur la sécurisation juridique des travaux relatifs au développement des énergies renouvelables (appels d’offres, avis formulés sur les tarifs d’achat), l’évaluation des charges de service public de l’énergie, les questions de raccordement aux réseaux et les dispositifs de soutien spécifiques aux zones non interconnectées.