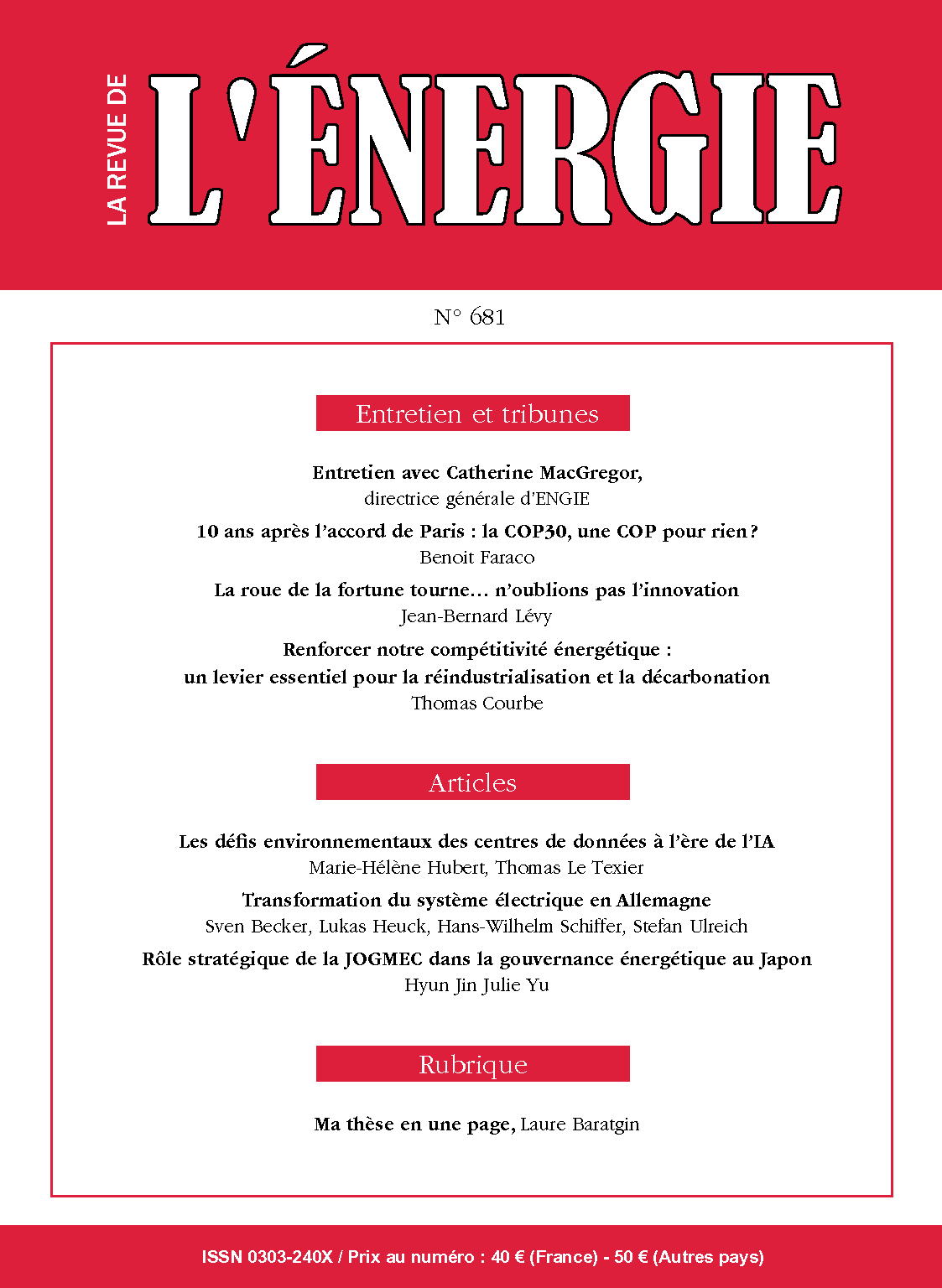Le développement des énergies renouvelables variables (EnRv) dans les systèmes électriques marque un profond changement de paradigme dans la gestion de la sécurité d’approvisionnement. Celle-ci repose aujourd’hui principalement sur une logique de stock d’origine exogène, où les sources d’énergie primaires, majoritairement fossiles, sont extraites des gisements — une forme de stockage — puis transportées aux lieux de consommation. Par rapport à la consommation finale (industrie, transport, bâtiment) de ces énergies, la consommation des centrales thermiques fossiles assurant l’équilibrage du système électrique est minoritaire. Sa sécurité d’approvisionnement est donc adossée à un autre système de consommation finale d’énergie, plus large.
Le remplacement de ces sources d’énergie primaires de stock par les EnRv (une source d’énergie primaire de flux) entraîne l’endogénéisation de la sécurité d’approvisionnement et la fermeture du bouclage énergétique. Or, cette production est variable à différentes échelles de temps, notamment saisonnières, annuelles et pluriannuelles. Cela nécessite des sources de flexibilité supplémentaires, en puissance ainsi qu’en énergie. Une des principales sources de flexibilité en énergie sont les stockages, dont l’étude technico-économique dans un système 100 % EnRv est l’objet de cette thèse.
L’exposition de ce stock garantissant la sécurité d’approvisionnement aux conditions météorologiques du système nécessite de le dimensionner et de le gérer en prévision des périodes de déficit d’énergie. Ces périodes sont exacerbées dans les mix 100 % EnRv mais apparaissent également dans les mix diversifiés à forte pénétration EnRv. Cela souligne la persistance du besoin d’une source de flexibilité en énergie capable de s’adapter à la variabilité EnRv. Certaines de ces périodes sont courtes et intenses (sur plusieurs jours consécutifs) et sont dorénavant bien identifiées. La thèse en caractérise d’autres, beaucoup plus longues (sur plusieurs mois consécutifs) qui bien que peu intenses en moyenne sont bien plus critiques en volume d’énergie : ce dernier peut atteindre l’équivalent de plusieurs semaines de consommation moyenne et détermine donc le niveau d’énergie à stocker en prévision de tels évènements. Or, ces déficits sont incertains et présentent une forte variabilité interannuelle. Ainsi, un effet pluriannuel apparaît, lié à l’enchaînement d’années elles-mêmes en déficit. Je montre alors que, du fait de son incertitude, une stratégie basée sur des transferts pluriannuels est fragile : une gestion annualisée du stock paraît recommandée et plusieurs stratégies sont déclinées.
Enfin, l’analyse du coût complet du système, du coût moyen du stockage ainsi que de son coût du capital m’a permis d’explorer les conditions économiques de tels mix. Je montre que la diversification des sources de flexibilité (exemple de l’écrêtement EnRv) ne permet pas de privilégier, de manière claire, un mix 100 % EnRv selon son coût complet. Néanmoins, l’introduction d’une consommation finale du vecteur de stockage (à destination d’un secteur industriel hydrogène par exemple) réduit ce coût grâce à la mutualisation des infrastructures de stockage. Elle réduit également le risque financier par la stabilisation de la volatilité interannuelle de la sollicitation des infrastructures qui impacte le coût du capital. En effet, les difficultés économiques d’un tel stockage assurant l’équilibre du système sont exacerbées par une sollicitation faible et volatile et un dimensionnement important, ainsi qu’un risque de cannibalisation entre les sources de flexibilité en énergie.
Ainsi, en s’interrogeant sur la place et le dimensionnement du système électrique dans le bouclage énergétique à forte pénétration EnRv, plusieurs familles de difficultés associées à sa variabilité sont illustrées. Cela ouvre la discussion sur le besoin de conserver ou de développer des actifs capables d’absorber cette variabilité et cela malgré des coûts et des risques financiers importants.
Laboratoire d’accueil
Cette thèse a été réalisée à Mines Paris-PSL, au Centre de Mathématiques Appliquées, au sein de l’école doctorale STIC (n° 580). Le CMA est l’un des 18 centres de recherche de l’école, fondé en 1976. Localisé à Sophia Antipolis, il est dirigé par Nadia Maïzi. Le CMA développe une démarche scientifique originale en déclinant ses compétences scientifiques fondamentales en modélisation, mathématiques du contrôle et de la décision afin d’aborder la question de la décarbonation de systèmes complexes dans une déclinaison multi-échelles, à la fois temporelles et spatiales. Ce positionnement original, qui mêle mathématiques fondamentales et enjeux climatiques, est l’aboutissement d’une stratégie scientifique visionnaire, initiée il y a une vingtaine d’années, les questions d’énergie associées aux changements climatiques et à la mondialisation ayant été l’occasion d’un renouvellement thématique sur les mathématiques de la décision dont le laboratoire a l’expertise, avec notamment la déclinaison récente du data mining. L’organisation des projets de recherche au CMA se décline selon trois axes : modélisation prospective, optimisation mathématique, données et apprentissage automatique.

Pour plus d’informations : https://www.cma.mines-paristech.fr/.
Soutenance de la thèse
La thèse a été dirigée par Sandrine Selosse, codirigée par Edi Assoumou, dans le cadre d’une CIFRE avec EDF R&D. Les encadrants industriels ont été Caroline Bono et Fabien Bricault.
La thèse a été soutenue le 4 décembre 2024 à Paris devant un jury composé de Gilles Guerassimoff, professeur, Mines Paris-PSL (président) ; Yannick Perez, professeur des universités, CentraleSupélec (rapporteur) ; Frédéric Lantz, professeur, IFPEN (rapporteur) ; Magnus Korpås, professeur, NTNU (examinateur) ; Sandrine Selosse, chargée de recherche, Mines Paris-PSL (directrice) ; Edi Assoumou, maître de recherche, Mines Paris-PSL (codirecteur) ; Caroline Bono, ingénieure-chercheuse, EDF R&D (examinatrice).
La thèse est disponible sur : https://theses.fr/2024UPSLM060.
Et après la thèse ?
Sébastien Pezza est actuellement ingénieur-chercheur au sein de la R&D de EDF. Il travaille sur l’économie du système électrique et énergétique, sur des sujets d’économie et de régulation des sources de flexibilités ainsi que sur l’intégration européenne des marchés électriques.